
Un avis sur Dystopia
Pierre-Alexandre Klein fut l’un des pioniers à tester l’expérience, il tenait à partager son avis. Welcome to the Matrix Cet après-midi j’ai eu la chance
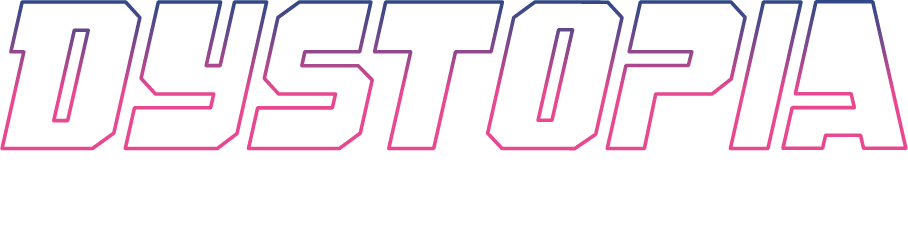
40€/humain
Soit un total de 120€
35€/humain
Soit un total de 140€
30€/humain
Soit un total de 150€
Dystopia est un Escape Game unique et captivant situé à Bruxelles, proposant une expérience immersive qui se démarque des autres jeux d’évasion de la capitale belge.
Dystopia se déroule dans un lieu insolite et historique, un laboratoire ultra-secret abandonné sous Bruxelles, généralement inaccessible au public. Cet Escape Game a été conçu par une équipe d’experts issus du jeu vidéo, de l’électronique et de l’art numérique, offrant ainsi une technologie sur-mesure qui vous plonge au cœur d’une aventure unique.
ExcellentBasée sur 255 avis
 Nicolas Maréchal31/01/2024Fantastique escape room. Un peu surpris d'être accueilli dans un petit couloir vieillot, on comprend rapidement que ça fait partie de l'atmosphère, et que cet entrepôt désaffecté est exactement la thématique recherchée. Les énigmes sont super intéressantes, il y a zéro cadenas ou clef, que des vrais mécanismes et de vraies énigmes à résoudre. On a adoré, je recommande!
Nicolas Maréchal31/01/2024Fantastique escape room. Un peu surpris d'être accueilli dans un petit couloir vieillot, on comprend rapidement que ça fait partie de l'atmosphère, et que cet entrepôt désaffecté est exactement la thématique recherchée. Les énigmes sont super intéressantes, il y a zéro cadenas ou clef, que des vrais mécanismes et de vraies énigmes à résoudre. On a adoré, je recommande! Anthony Rouneau27/01/2024Expérience top ! On a fait toutes les escape rooms de Bruxelles, et celle-ci se démarque clairement par son originalité, son humour et ses mécaniques. A recommander sans hésitation !
Anthony Rouneau27/01/2024Expérience top ! On a fait toutes les escape rooms de Bruxelles, et celle-ci se démarque clairement par son originalité, son humour et ses mécaniques. A recommander sans hésitation ! Marcia Hisette23/01/2024Escape Game qui sort de l’ordinaire et hyper immersif !
Marcia Hisette23/01/2024Escape Game qui sort de l’ordinaire et hyper immersif ! Jonathan Vigne15/01/2024Un des meilleurs Escape Game de Bruxelles !
Jonathan Vigne15/01/2024Un des meilleurs Escape Game de Bruxelles ! Baptiste Puhl14/01/2024Quelle claque ! Cette salle est une pépite, et s'inscrit directement dans les tops des meilleures salles sur Bruxelles. Inventive, logique et fun, l'aventure qu'elle propose, idéalement pour 2-3 joueurs, nous a transportée pendant une heure et nous avons adoré chaque moment. Les moindres détails et références sont travaillées, pour une immersion parfaite. Le lieu choisi, une ancienne armurerie, aide énormément en cela, et il ne faut pas hésiter à donner de la force pour ouvrir quelques vieilles portes blindées ! L'ambiance sonore et lumineuse offre un spectacle permanent, difficile de croire que les gérants et créateurs n'avaient jamais fait d'escape avant d'imaginer celle-ci ! Côté énigme on reste sur du facile, avec toutefois de très beaux mécanismes et une utilisation des technologies impressionnantes ! Mention spéciale pour l'humour, qui léger et bien dosé, vient parfaire le tout !
Baptiste Puhl14/01/2024Quelle claque ! Cette salle est une pépite, et s'inscrit directement dans les tops des meilleures salles sur Bruxelles. Inventive, logique et fun, l'aventure qu'elle propose, idéalement pour 2-3 joueurs, nous a transportée pendant une heure et nous avons adoré chaque moment. Les moindres détails et références sont travaillées, pour une immersion parfaite. Le lieu choisi, une ancienne armurerie, aide énormément en cela, et il ne faut pas hésiter à donner de la force pour ouvrir quelques vieilles portes blindées ! L'ambiance sonore et lumineuse offre un spectacle permanent, difficile de croire que les gérants et créateurs n'avaient jamais fait d'escape avant d'imaginer celle-ci ! Côté énigme on reste sur du facile, avec toutefois de très beaux mécanismes et une utilisation des technologies impressionnantes ! Mention spéciale pour l'humour, qui léger et bien dosé, vient parfaire le tout ! Ali Ismail05/01/2024Wow, expérience incroyable Rien à voir avec Terre Neuve! Et la fin.... Rarement, je me suis autant senti immergé....
Ali Ismail05/01/2024Wow, expérience incroyable Rien à voir avec Terre Neuve! Et la fin.... Rarement, je me suis autant senti immergé.... Michael Piron05/01/2024top.
Michael Piron05/01/2024top.
Avec vos ami(e)s ou collègues de travail, constituez votre équipe de 3 à 6 joueurs.
Consultez les prix et choisissez votre date via notre agenda en ligne.
Sauver le monde en protégeant la meilleure Intelligence Artificielle jamais construite de la destruction imminente.
Vous n’avez que 60 minutes pour assembler le vaisseau qui permettra de la mettre en sécurité.
Venez découvrir un escape game nouvelle génération à Bruxelles.
Explorez plus de 100 m² d’un laboratoire ultra-secret abandonné sous Bruxelles.
Serez-vous à la hauteur de cette mission cruciale ?
Notre engagement ? Vous offrir un escape game innovant et inoubliable, qui saura ravir tous les amateurs d’aventures et de défis modernes, facilement accessible en centre de Bruxelles, à deux pas de L’ULB.
Vous êtes l’élite des Cyber-Hackeurs, formés pendant des années dans les ruelles du Neo-Europa.
Votre expérience des environnements les plus hostiles de vous a permis de développer une expertise inégalée en matière de hacking. Vous êtes les seuls capables de résoudre les nombreux pièges et énigmes du laboratoire abandonné.
Votre connaissance pointue des technologies les plus avancées et votre maîtrise des techniques de défense les plus sophistiquées font de vous la meilleure chance de réussite pour cette mission dangereuse et complexe.
Un mystérieux commanditaire, surnommé le DOC, vous contacte pour une mission cruciale : sauver sa dernière création, le « Programme for the Establishment of AI for the Common Era of Earth » », également connu sous l’acronyme de P.E.A.C.E.
Cette IA est la plus perfectionnée du monde et a été conçue pour aider les gouvernements à prendre des décisions éclairées.
Toutefois, en raison des protestations de la population, le projet a été abandonné.
Votre mission consiste à récupérer P.E.A.C.E. et à la mettre en sécurité avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.
Une intelligence artificielle ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passive, laisser cet être humain exposé au danger.
Une intelligence artificielle doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi.
Une intelligence artificielle doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.
Notre escape room est située à l’adresse suivante :
Avenue de la Couronne 227,
1050 Ixelles
Belgique
Dystopia est le fruit d’un projet commun réunissant développeurs issus du jeu vidéo, de l’électronique, et de l’art numérique.
En alliant subtilement électronique et code, nous avons créé une technologie sur-mesure, qui vous transporte dans une aventure immersive unique et inoubliable.
Dystopia a été conçue dans le cadre de l’occupation temporaire SEE-U, dans une volonté commune de proposer un nouvel escape game à Bruxelles dans un lieu atypique. Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de Pali-Pali pour son soutien.
Si vous envisagez de vivre l’expérience inoubliable de l’Escape Game Dystopia à Bruxelles, vous vous posez peut-être des questions sur les détails pratiques et les particularités de cette aventure. Afin de vous aider à préparer au mieux votre visite, nous avons rassemblé les questions les plus fréquemment posées par nos participants et y avons apporté des réponses claires et précises.
L’escape game a un niveau de difficulté modulable. Vous pouvez spécifier au personnel de dystopia dès l’entrée la difficulté souhaitée (easy, medium, challenge). Que vous désiriez relever le défi, ou passer un moment immersif et détendu entre amis, l’expérience Dystopia est faite pour vous.
L’âge minimum est de 14 ans.
La présence d’un adulte (> 18 ans) est obligatoire dans un groupe.
Si un ou des joueuse/joueurs s’ajoutent en dernière minute il n’y a pas de problème, vous pouvez payer le complément sur place.
Attention, Dystopia est limitée à 6 joueurs maximum.
Sur place nous acceptons uniquement les paiements par carte bancaire.
Conformément aux conditions générales de vente qui sont acceptées lors de la réservation, aucun remboursement ne sera effectué lors d’une annulation de votre part. Néanmoins, vous pouvez contacter notre équipe 24h avant la séance. Sous réserve de disponibilités, nous discuterons d’une autre date.
La difficulté est modérée par l’octroi d’indices.
Il y a une épreuve physique dans un espace confiné qui reste optionnelle. Vous aurez le choix de la faire.
À aucun moment de l’aventure vous ne vous retrouverez enfermé, il est toujours possible de faire demi-tour ou de sortir de la salle si besoin. De plus, une surveillance constante est effectuée par notre maître du jeu afin de prévenir tout problème.
oui, vous pouvez nous envoyer un email à hello[at]dystopia.brussels pour toute information et demande de devis.
90% de l’espace est accessible à une chaise manuelle (70cm de large), avec deux marches de 10cm à franchir au début. Plusieurs épreuves nécessite d’être en position debout.
Découvrez notre blog dédié à l’actualité des Escape Games à Bruxelles ! Ici, nous partageons avec vous les dernières tendances, les nouveautés et les événements marquants du monde des jeux d’évasion dans la capitale belge. Que vous soyez un passionné d’énigmes, un amateur de défis entre amis ou à la recherche d’idées originales pour vos sorties en famille, notre blog est la ressource incontournable pour rester informé sur l’actualité des Escape Games à Bruxelles.

Pierre-Alexandre Klein fut l’un des pioniers à tester l’expérience, il tenait à partager son avis. Welcome to the Matrix Cet après-midi j’ai eu la chance

Un projet de deux ans 2020, le monde sort d’un premier été sous le signe de la pandémie, et s’apprête à plonger pour quelques mois
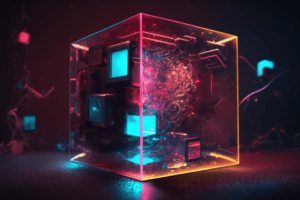
Bruxelles, la capitale belge, est réputée pour sa richesse culturelle et ses nombreuses attractions touristiques. Parmi les expériences inoubliables que la ville a à offrir,
Pour toutes questions, contactez-nous par téléphone ou par email. Vous pouvez également consulter notre liste de prix et réservez via le bouton suivant.
OXYKUBE SCRL ▰ 2023 | Droits Réservés